|

Traumatisme
et Transmission,un double reflet de la trace
Rencontre
du 22 novembre 1997, au Cercle, Avignon.
(Introduction
et résumés)
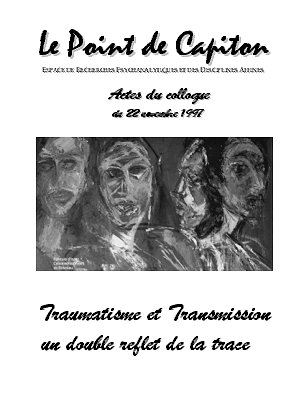
Commander
le recueil - 58 pages format A4
Introduction
Simone
Molina.
Dans " L’ombilic du rêve ",
Laurence Bataille, belle-fille de J. Lacan et fille de
Sylvia et Georges Bataille, écrivait : " Mon
métier consiste à m’allier avec ceux qui me le demandent
pour aller agiter ces archives incandescentes ".
Il n’est pas hasardeux que ce soient les propos de
Laurence Bataille qui me soient revenus en mémoire, au
moment où j’écrivais ce texte : Laurence Bataille,
en 1954, fait un voyage en Algérie où elle joue un rôle
dans une troupe de théâtre. Elle participera au printemps
1958 à un réseau d’aide au FLN, tout en poursuivant
ses études de médecine. Elle sera emprisonnée pour ses
activités politiques en Mai 1960, et relâchée six semaines
plus tard, après un non-lieu obtenu par Rolland Dumas.
Alors qu’elle est en prison, Lacan lui apporte les
feuilles dactylographiées de son séminaire sur l’Ethique
de la psychanalyse : Un commentaire sur la révolte d’Antigone
contre Créon.
" Antigone est une tragédie, et la tragédie
est présente au premier plan de notre expérience, à nous
analystes. " disait Lacan lors de ce séminaire
de 1960. Il se trouve qu’il existe des tragédies
dont la particularité est qu’elles soient nouées
avec une tragédie dans le cours de l’Histoire. C’est
de ces tragédies là que nous parlerons aujourd’hui.
Leurs effets sont présents dans la culpabilité inconsciente
qui habite, et submerge parfois, les descendants de ceux
qui les ont vécues. Cette culpabilité précède et détermine
l’acte, elle se manifeste en creux dans les actes
du sujet. Lorsque quelque chose de cette histoire tente
de s’inscrire, c’est toujours dans la souffrance
et le dépassement, c’est-à-dire aussi, dans la transgression.
La psychanalyse elle-même est née d’une transgression.
Pour Freud, le véritable enseignement vient du patient.
Lorsque Jacques Lacan énonce à propos de la résistance,
qu’elle est toujours du côté de l’analyste,
il ne dit pas autre chose que ceci : Qu’est-ce que
l’analyste ne veut pas entendre, ou ne peut pas entendre
?
C’est pour appréhender ce qui se passe entre lui
et son patient, que Freud se forge une théorie, qu’il
situe lui-même comme appartenant à l’ordre de la
fiction. Il découvre alors dans son travail clinique que
c’est le transfert qui est la résistance, en ce sens
que le transfert est bien ce qui est à situer " entre ",
dans un écart entre le dire du patient et l’écoute
de l’analyste, dans un espace qui n’appartient
ni à l ’un, ni à l’autre, mais qui, les
concernant l’un et l’autre dans leur rapport
à l’inconscient, permet que la cure se poursuive
avec les effets de voilement et de dévoilement que suppose
une parole adressée.
Cette autre fiction, que l’on connaît sous le vocable
de " roman familial du névrosé "
est cette part de la psychanalyse la plus vulgarisée qui
fait dire aux parents "bien informés "
que leur enfant "a son œdipe ",
comme ils parleraient d’une maladie dont il s’agirait
de se défaire. Mais, comme l’écrit S.Ginestet-Delbreil,
dans son livre " La terreur de penser "
: " L’enfant caractériel
ou insomniaque, même s’il ne le formule pas avec
des mots, pose la question de son être au monde ".
C’est dire que les choses sont plus complexes que
la trilogie "papa-maman-bébé ", parce
que l’homme est un être de langage et, qu’il
n’est pas seulement pris dans son "roman familial "
; il est pris, à travers son roman familial et la question
de sa place, dans ce que l’on nomme "la
culture ", si l’on veut bien entendre
par-là le bain de langage spécifique propre à une époque,
certes, mais aussi à une Histoire, et aux non-dits de
cette Histoire, c’est-à-dire aux "trous
de mémoire ".
Il existe les "trous de mémoire "
que sont les secrets de famille, qu’il s’agisse
par exemple d’un suicide, ou d’un acte violent
qui a entraîné une sanction pénale soigneusement cachée
en voyage, ou de quelqu’autre événement traumatique
dans l’histoire familiale. Lorsqu’un sujet affronte
l’interdit de dire et pose des questions dans le
cadre familial quant à ces secrets, ce n’est jamais
sans angoisse, car parler, dans ce cas, c’est transgresser.
Il en est de même lorsque la transgression concerne aussi
la sphère sociale.
En effet, certains événements traumatiques vécus par des
sujets impliquent le collectif d’une façon plus élargie
que la sphère familiale : " L’autre
guerre " dont parle J. Hassoun, pour nommer
la Shoah ; ces guerres nommées, puis oubliées : "Abolition
de la citoyenneté française aux juifs d’Algérie sous
le gouvernement de Vichy ", mais aussi
ces guerres déniées en tant que telles : " Evénements
d’Algérie ", ou " Maintien
de l’ordre en Algérie ", par l’armée
française, les appelés du contingent, et par les Français
musulmans que l’on nomme les harkis".
| |
Lorsqu’un
sujet s’y est trouvé pris, comment, pour lui-même,
se nouent de façon névrotique différents temps de
l’Histoire ? Et comment ses descendants peuvent-ils
"faire histoire ", d’un événement
dont la transmission, dans le discours familial
et social, a été plus ou moins muette ? Telles sont
les questions qui se posent parfois, dans la pratique
clinique d‘une psychanalyste. Ces questions
peuvent aussi participer de ce qui cause le désir
d’occuper cette place de l’analyste, puis
de la tenir dans le tranchant de ce que l’on
peut appeler, avec Jacques Lacan "la subversion
du sujet et la dialectique du désir "
|
| |
En
1938, Jacques Lacan publie, dans l’Encyclopédie
Universelle, un texte intitulé " Les complexes
familiaux ". Voici ce qu’il écrit
: " " Le psychanalyste
peut-il prétendre guérir l’homme de ses défaillances
psychiques sans le comprendre dans la culture qui
lui impose les plus hautes exigences, (...) "(p70)
et plus loin dans ce texte : " Le
sublime hasard du génie n’explique peut-être
pas seul que ce soit à Vienne- alors centre d’un
Etat qui était le melting-pot des formes familiales
les plus diverses (...) - qu’un fils du patriarcat
juif ait imaginé le complexe d’Œdipe.(p
73) ". Dans ce texte Lacan indique
que ce qu’il appelle " la grande
névrose contemporaine ", a pour détermination
principale " la personnalité du père,
toujours carente en quelque façon, absente, humiliée,
divisée ou postiche ".
|
Ainsi, malgré les ajustements théoriques qu’il fera
plus tard quant à la question de la guérison, par exemple,
il pose, dès l’abord, la question du père comme au
fondement de la structure du sujet, en insistant sur le
nouage avec la culture, c’est-à-dire sur les inscriptions
institutionnelles.
" Fabriquer le lien institutionnel, c’est
l’œuvre de la généalogie, qui fait tenir le
fil de la vie, rappelle au sujet son assignation dans
l’espèce, procure à la société son matériau vivant.
L’étude de ce lien conduit à mettre en rapport le
biologique, le social et l’inconscient, à reprendre
sur cette base l’observation de la fonction juridique,
qui, dans son essence consiste à produire artificiellement
le nouage de ces trois indices humains. "
écrit le juriste Pierre Legendre.
Entendons bien ce que dit Legendre : la fonction juridique
produit artificiellement, le nouage de ces trois indices.
Autrement dit : c’est un forçage, qui, s’il
n’est pas soutenu par ce qu’il en est du rapport
au père en tant qu’il est celui qui nomme et reconnaît
un enfant pour le sien, un forçage donc qui peut révéler
la faille dans laquelle le sujet se tient, ou au contraire,
peut y parer, pour un temps
La question se pose de savoir comment un homme peut devenir
père et tenir, pour son enfant cette place de père, lorsqu’il
a été lui-même confronté à la négation de son existence
en tant qu’être humain (c’est la douloureuse
question posée par leurs enfants, aux rescapés des camps
de la mort nazis) ou lorsqu’il a été en but à l’exclusion,
politiquement décidée, d’une communauté humaine (ce
fut le cas des citoyens français d’origine juive
en Algérie sous le régime de Vichy), ou à l’exclusion
de fait, mais déniée dans le discours social : tel est
le cas des harkis arrivés en France en 1962.
Ce qui fait alors problème est le nouage entre la loi
symbolique et le juridique, avec la difficulté psychique
de soutenir le paradoxe suivant : le juridique, qui devrait
représenter la loi symbolique qui instaure l’humain-parlant,
contrevient à ses fondements même, par la mise en place
de lois scélérates qui prônent et légitiment l’exclusion.
Ce détour par l’Histoire et par le fondement du droit
pour un sujet donné, permet de saisir, dans la clinique,
en quoi les symptômes d’un sujet peuvent venir recouvrir,
une douleur et un questionnement qui ont partie liée avec
l’Histoire. Cette douleur et ce questionnement sont,
certes, ceux de tout sujet : " Qui parle
? A qui ? De quel lieu ? et encore : Que veux-tu
? ". Mais lorsque les fondements institutionnels
sont impliqués et ont participé du traumatisme, on prend
le risque, si on élude la dimension de l’Histoire,
c’est-à-dire celle de l’institution qui fait
lien social, on prend le risque donc, de soutenir ce phantasme
: " cela n’a pas eu lieu ".
Or, lorsqu’un événement est dénié, les effets du
déni apparaissent sous la forme la plus mortifère qui
soit : la violence contre l’autre ou contre soi-même,
dans un équivalent tragique : quelqu’un ne doit pas
exister. Cette affirmation inconsciente : "quelqu’un
ne doit pas exister ", fait entrer le sujet
dans le domaine de l’arbitraire, y compris pour ce
qui le constitue comme être vivant, c’est-à-dire
la parole, support du symbolique. Lorsque l’autre
sait tout, le sujet à qui il est renvoyé que c’est
l’autre qui sait pour lui, ne sait pas quoi dire
et demeure muet dans une pétrification de la pensée. Cette
pétrification de la pensée, indique, pour l’analyste,
quelque chose quant au savoir inconscient du sujet car
: " Le paradoxe dans lequel est le sujet
qui ne parle pas, parce qu’il " ne sait
pas quoi dire ", tient à ce que le fait même
de se poser cette question signifie que, en fait, il sait
inconsciemment ce qu’il redoute de dire : il
le sait, car, vivant sous le regard de l’Autre, qu’il
n’oublie pas, il est amené à parler en s’observant,
pour ne pas énoncer le lapsus que le regard attend déjà
de lui " (p72 A.D Weill)
PROGRAMME
Mireille
Nathan-Murat: " Identifications à un destin de génocide"
("Poursuivi par la chance" Ed L’Harmattan)
Il ne suffit pas
de ne pas pouvoir oublier pour se souvenir. Avant même
de s’exercer au devoir de mémoire, les enfants des
survivants de génocides reçoivent en héritage l’empreinte
indélébile de la ségrégation raciste, du marquage, de
la séparation, de la relégation, de la déportation et
de la destruction étatiquement orchestrée. J’en témoigne
comme fille et petite-fille de Français d’origine
juive qui ont résisté au génocide perpétré par le gouvernement
français de Vichy et l’état nazi avec lequel il collabora.
Psychanalyste, j’interrogerai l’emprise mortifère
de la cruauté légalisée dont les parents furent l’objet.
Hélène
Piralian : "Quand l’autre disparaît. Eclipse
ou destruction"
("Génocide et Transmission" Ed L’Harmattan)
Si le projet génocidaire
vise avant tout la destruction de la Transmission, c’est-à-dire
la disparition de l’autre comme constituant du sujet,
quelles conséquences cette disparition a-t-elle pour les
survivants ? Peut-il y avoir pour eux, pour certains,
une ré(ins)tauration de l’autre, et dans ce cas,
dans quelles conditions et sous quelles formes?
Simone
Molina : "Entre deux rives et deux oublis"
Certains
événements traumatiques impliquent le collectif: "
L’autre guerre " dont parle J. Hassoun, pour
nommer la Shoah. Ces guerres nommées, puis oubliées :
"Abolition de la citoyenneté française aux juifs
d’Algérie sous le gouvernement de Vichy ", mais
aussi ces guerres déniées en tant que telles : "
Evénements d’Algérie ", " Maintien de l’ordre
par les français musulmans". Lorsqu’un sujet
s’y est trouvé pris, comment ses descendants peuvent-ils
" faire histoire " d’un événement dont
la transmission a été plus ou moins muette?
Jacques
Hassoun: interviendra comme
discutant de cette rencontre, à partir de son ouvrage
récemment paru " L’obscur
objet de la haine ".
(Ed Aubier 1997)
Sonia
Lawniczak: Rétrospective - Gouaches et Acryliques
"Nostalgie
d’un temps où je pouvais " mettre mes cauchemars
en peinture", tout nus, en pleine force. Maintenant
que ma douleur est moins vive,(...) j’ai l’impression
que ma peinture reflète une fadeur nouvelle, comme ce
corps retrouvé, si lourd, si encombrant, si coupable.
Car ces personnages que j’ai peints, je les aime
(...) Ils étaient la représentation de retrouvailles:
à la fois moi et les morts - ma mère et ses déportés qu’elle
avait rejoints(...).
Extrait d'un texte de Sonia Lawniczak. publié
dans le livre de Mireille Nathan-Murat
"Poursuivi par la chance De Marseille à Buchenwald-
Mémoires partagées."
1906-1996 " (Ed L'Harmattan)
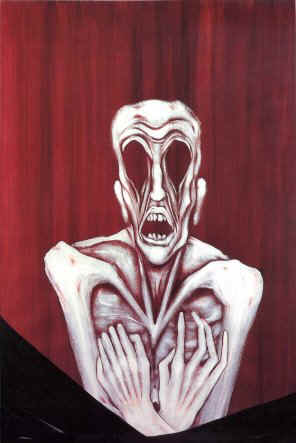
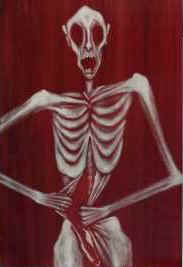
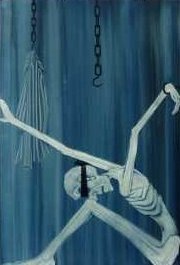
3 Oeuvres de Sonia
Lawniczak
L’atelier
de photographie "Nadar"
l’atelier d’écriture "Papier
de Soi"
Service du Dr Pandelon (Montfavet)
"La trace comme une
image"
|

